
Le traité d’Aix-la-Chapelle, ou comment Emmanuel Macron trahit la souveraineté nationale française

À lire le texte du « traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes » qu’Emmanuel Macron a signé le 22 janvier 2019 dans l’ancienne capitale carolingienne d’Aix-la-Chapelle, on est partagé entre l’indignation et la consternation.
Indignation, parce que le contenu de ce texte, loin d’emmener les deux pays dans la direction d’un avenir plus juste, est la perpétuation de décennies de libéralisme extrême, dont les nations européennes et leurs peuples paient chaque jour le prix. Parce que ce traité, loin de consacrer l’alliance toujours plus étroite de deux nations souveraines, institue leur soumission servile aux États-Unis, à la suzeraineté desquels, au travers de l’Alliance atlantique, les deux gouvernements se soumettent sans ciller. Et pour finir parce que les termes de ce traité sont à sens unique : « la coopération et l’intégration » vont systématiquement dans le sens d’un alignement de la France sur son voisin d’outre-Rhin, sans jamais de contreparties sérieuses.
Et c’est là que s’installe très vite la consternation : comment un gouvernement, comment un président de la République, comment le ministère des Affaires étrangères d’une grande puissance – ou tout au moins d’une aussi respectable diplomatie – peuvent-ils négocier un texte d’une aussi abyssale nullité ? Lire le traité d’Aix-la-Chapelle, c’est en effet découvrir phrase après phrase un texte non seulement creux – sauf lorsqu’il perpétue l’idéologie libérale ou l’atlantisme le plus vil – mais aussi totalement déséquilibré. Car si l’Allemagne, manifestement meilleure négociatrice, obtient de sérieuses concessions, dont la plus spectaculaire est de mettre la diplomatie française au service de l’ambition berlinoise d’accéder à un siège permanent au conseil de sécurité des Nations-Unies (pour, n’en doutons pas, mieux en évincer la France, sans doute via un siège « européen »), la France n’obtient absolument rien de tangible. Nous, Français, ne savons manifestement plus comment on négocie un accord, puisqu’il semble désormais entendu que, pour nos gouvernants, la France doit désormais accepter de renoncer à toute volonté et tout intérêt propre : elle doit accepter l’abolition de sa souveraineté.
On comprend mieux ainsi pourquoi ce texte, négocié en catimini, n’est paru dans la presse qu’à quelques jours de sa signature, et encore sur la base de sa version allemande qu’il a fallu traduire, la version française « officielle » demeurant jusqu’au dernier moment introuvable… Quand la forfaiture le dispute à ce point à l’imposture, quand on s’apprête à aller non à Canossa mais bien à un Montoire libéral, il vaut sans doute mieux en effet rester discret.
La cerise sur un gâteau déjà fort chargé est sans doute la référence faite en préambule au traité de l’Élysée de 1963, sans doute pour mieux en trahir la lettre comme l’esprit. Ce traité gaullien, en effet, remplissait avec intelligence deux fonctions essentielles. D’une part, pacifier durablement les relations entre la France et l’Allemagne, en posant les bases d’un rapprochement non seulement des deux États, mais des deux peuples. D’autre part, créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une véritable souveraineté en Europe, c’est-à-dire la seule possible : celle faite de la rencontre, et non d’une illusoire fusion, des souverainetés nationales de ses peuples. Certes le Bundestag, en imposant une mention à l’OTAN dans le préambule du traité, a porté un coup fatal à ce second volet et rendu l’Allemagne responsable de l’impuissance européenne. Mais même ainsi, le traité de l’Élysée donnait au moins à la politique allemande de la France une ligne directrice claire.
Or Aix-la-Chapelle, par-delà sa médiocrité formelle, est de ce point de vue une double trahison, qui résume bien le danger que représente pour la France – mais aussi pour toute l’Europe – la politique d’Emmanuel Macron, de son gouvernement et de sa majorité.
Trahison du rapprochement franco-allemand, d’abord. Lorsque les deux États affirment qu’ils « approfondissent l’intégration de leurs économies » (art. 20), il ne s’agit en réalité que de « favoriser la convergence entre les deux États et d’améliorer la compétitivité de leurs économies ». On ne sait que trop ce qui se cache derrière ce vocabulaire : l’acceptation par la France du suicidaire « ordo-libéralisme » allemand, mélange malsain de rigidité idéologique et d’idéologie dérégulatrice. Il est faux de prétendre, comme ne manquera pas de le faire le gouvernement, que l’Allemagne acceptera de ce point de vue des concessions. Pour des raisons historiques, intellectuelles, mais aussi et plus prosaïquement parce que Berlin tire avantage de l’état actuel des déséquilibres économiques en Europe, il n’en sera rien.
Ce sera donc le pire des deux mondes ! Car comment ne pas voir que, soumise à ce régime, l’économie française loin de se redresser va au contraire poursuivre sa tertiarisation, sa satellisation vis-à-vis de la toute-puissante industrie allemande ? Comment ne pas comprendre qu’il s’agit là de la poursuite d’une voie qui, si elle arrange l’Allemagne à court terme, crée à moyen terme les conditions de son isolement, puis de son rejet par des peuples européens qui ne supporteront pas longtemps une telle domination ? Comment, enfin, être aveuglé au point de ne pas réaliser qu’il s’agit, à long terme, de la voie la plus sûre pour marginaliser l’Europe dans l’économie mondiale ? Car le mercantilisme libéral allemand repose, en l’absence de protectionnisme, sur la soumission politique de la République fédérale à ses principaux clients : d’abord aux États-Unis bien sûr, ce débouché privilégié des industries allemandes de pointe, fortement implantés – capitalistiquement autant que militairement – en Allemagne depuis 1945. Mais aussi à la Russie, certes fournisseur d’hydrocarbures mais surtout lucratif débouché pour les machines-outils et l’automobile ; et finalement à la Chine, eldorado de l’industrie allemande de consommation haut de gamme, et objet de toutes les attentions germaniques.
Lorsque l’abaissement des droits sociaux rencontre ainsi l’avilissement politique, alors même que les « gilets jaunes » défilent chaque semaine en chantant la Marseillaise sous les couleurs bleu-blanc-rouge, cela ne peut avoir qu’une seule conséquence : développer la germanophobie en France, comme elle se développe ailleurs en Europe. Lorsque la France aura aligné son droit du travail sur l’Allemagne, aligné son droit des affaires, « austérisé » ses politiques sociales, le tout au nom du rapprochement franco-allemand ; lorsqu’elle sera devenue à la fois satellite de la version post-moderne de la « grande Allemagne » – et c’est déjà bien engagé – et marginalisée au plan mondial, comment pourrait-il en être autrement ?
Car l’autre trahison, très nette, est bien celle de l’intérêt national français. Tout au long du texte, la France ne cesse de s’aligner sur des conceptions qui devraient lui être étrangères : en soumettant la défense de l’Europe à l’OTAN, obérant l’idée même d’une « autonomie stratégique » européenne, en alignant son économie et son droit sur son voisin au nom de « l’intégration », mais aussi en plaçant des fonctionnaires allemands à tous les niveaux de sa diplomatie – car, au vu du réseau diplomatique des deux pays et de la place de la France aux Nations-Unies, on voit mal quel bénéfice Paris peut, à l’inverse de Berlin, tirer des échanges prévus – et en allant quémander pour l’Allemagne un siège de membre permanent au conseil de sécurité onusien.
Moins immédiatement perceptible, mais tout aussi grave, la conception fédérale allemande triomphe manifestement de l’idée de République une et indivisible qui définit pourtant l’État en France : en distinguant les régions frontalières et les autres – ce que ne faisait évidemment pas le traité de l’Élysée – le président de la République va apposer sa signature à un document manifestement contraire à l’esprit des institutions – certes, ce ne sera pas une première depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Mais, s’il n’est évidemment pas question de cession de l’Alsace-Lorraine – grossièrement dénoncée par le Rassemblement national, toujours prompt à abêtir le débat politique français –, il s’agit bien d’un abandon symbolique des régions frontalières : comment ne pas voir en effet que, par ce traité, la France en abandonne le développement économique au développement de liens transnationaux ? Renonce à y mener sa propre politique en acceptant leur satellisation économique aux puissants Länder d’outre-Rhin, qui conserveront évidemment l’essentiel de la valeur ajoutée chez eux ? Car les mesures envisagées ne comportent aucun véritable plan de développement économique : il ne s’agit que de créer des conditions (infrastructures, simplification administrative…) d’où, certainement, le dieu-marché doit par son action de grâce générer de la richesse.
Voici mise à nu la pensée magique qui tient depuis des décennies lieu de stratégie économique aux élites françaises. Ajoutons dans l’abandon par le gouvernement de ses responsabilités que le « bilinguisme » vanté par le traité se fera sans doute à l’allemande : par extension de la langue allemande au détriment non seulement du français mais, d’abord, des langues régionales. Sans doute, ignorant de la culture française dont il prétend qu’elle n’existe pas, M. Macron ignore-t-il que l’alsacien et le francique (parlé en Moselle), reconnus depuis 1992 comme langues régionales de France, ne sont pas de l’allemand ! Il faudrait en tout cas qu’il relise la Constitution, qui rappelle que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (article 75-1).
Finalement, au prix de tout ceci, qu’obtient la France en échange ? Rien. Quelques vagues promesses sur l’Afrique, quelques engagements de coordination militaire – et il y aurait de ce point de vue beaucoup à dire sur le volet industriel, tant l’Allemagne poursuit là encore un mercantilisme qui s’oppose déjà à l’élaboration d’une souveraineté industrielle de l’Europe –, mais rien de plus. L’Allemagne, habilement, n’a pas pris d’engagements que sa culture politique et ses intérêts lui auraient interdit de tenir. Quel pouvoir peut encore être légitime à présider à la politique étrangère de la France lorsqu’il témoigne ainsi de son incapacité non seulement à défendre, mais même à définir l’intérêt national ? En lisant le traité d’Aix-la-Chapelle, une seule chose est claire : ce pouvoir ne peut plus être celui de M. Macron.
Version originellement publiée sur le site vududroit.com le 25 janvier 2019.



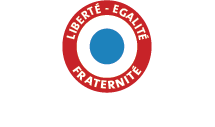
![[Article modèle] Bienvenue sur la page des militants [du département] de République souveraine ! [Article modèle] Bienvenue sur la page des militants [du département] de République souveraine !](https://www.republique-souveraine.fr/wp-content/plugins/bold-page-builder/img/blank.gif)